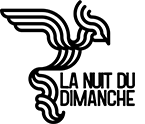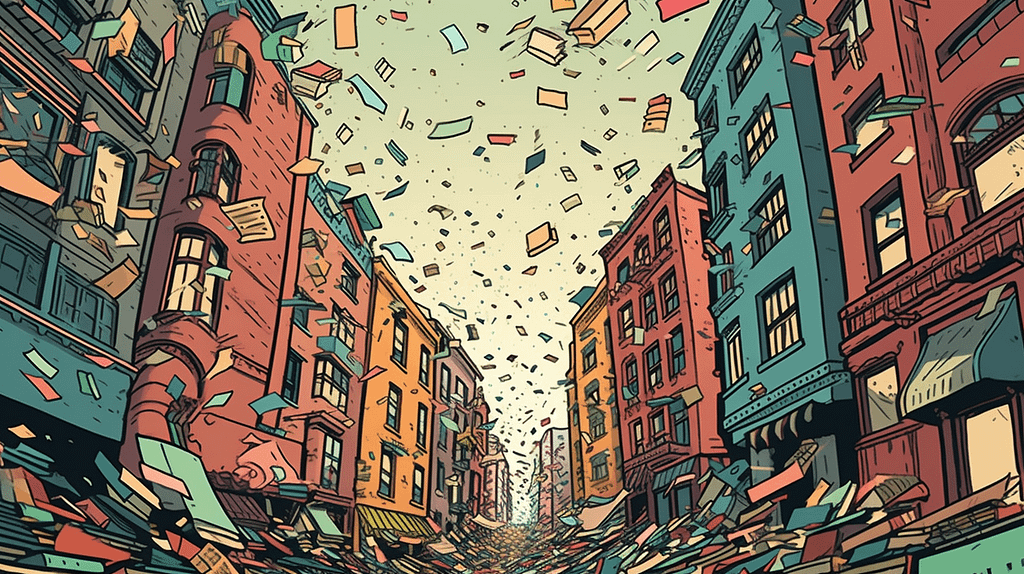Il pleut des livres, c’est la panique.
Personne ne sait d’où ils viennent, qui les fabriquent, ni comment tout cela a commencé, mais voilà. Un beau matin, le sol était jonché de livres trempés.
Des livres toutes sortes, de toutes tailles, des livres d’art, des livres policiers, des livres de l’espace, des livres pour WC. Ce n’était pas la faute des météorologistes, encore moins celle des femmes-troncs qui, elles, avaient au moins la bonté de prévenir des averses.
Alors qui, alors quoi, alors comment ? Le monde s’en foutait, mais royal, la vérité scientifique, très peu pour le monde, non merci, next ! Le monde blâmait les fabriquant de parapluie qui n’étaient pas assez solide pour supporter les chutes de livre. Alors quoi ? Alors combien ? On vociférait sur les plateaux télés, on invectivait de qui de droit, personne et tout le monde à la fois. Des gens gagnaient du galon pour leur colère, d’autres en gagnait pour leurs appels au calme. Alors qui, alors quoi, alors combien ?
Sur les ondes, dans les télés, sur les écrans de smartphone, partout s’affichait le nombre d’accident, le nombre de mort et la même question : y-aura-t-il un vaccin pour Noël ? Et combien de mort encore par la chute d’un Beigbeder ou d’une anthologie sur Kokoschka ?
Puis les humoristes sont arrivés, ils ont débarqué avec leurs Scholl d’avant la pluie, avec leurs façon de marcher qui ne laisse aucune empreinte dans le sable. Ils ont dit des trucs. Des centaines d’humoristes qui disent la même chose, c’est tordant. Pis c’est pas si facile, surtout sans coordination, surtout sans savoir ce que l’autre va dire.
Le dira-t-il mieux, le dira-t-il autrement, le dira-t-il bêtement ? C’est de la haute voltige, tous ces humoristes qui disent. En se prenant au sérieux.
C’est corrosif le sérieux, ça ronge les parapluies, c’est pas comme la pensée, qui, elle, laisse des traces. Le sérieux, ça moribonde une soirée, avec ou sans livres, ça enflamme les esprits, ça rends les gens aussi vénères que si on les frappait avec des livres de façon inopinée et de façon répétée. Y a de quoi rendre fou. Y a de quoi le devenir.
Non, j’avais définitivement besoin de légèreté, de repos de l’âme et de l’esprit, de petites bulles savonneuses virevoltant autour de moi à chaque mouvement de bras. J’avais besoin de détente. Rien à base d’alcool. J’ai branché Disney+.
She-Hulk, elle est tellement forte, son métabolisme est tellement ouf que l’alcool ne lui fait aucun effet. Elle en boit comme du petit lait. C’est une série post Avengers, post blip, qui s’intègre entre les autres séries et les autres films dans le grand tout Marvelesque. Elle s’intègre on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Le MCU ressemble pour le moment à une fin de partie de Tetris. Rien n’a de sens, rien ne va, on sent bien qu’on est perdu. Ce serait un miracle si on tombe sur la simple ligne droite qui remettrait un peu d’ordre et de cohésion dans tout ça. On est dans l’attente de cette pièce, celle qui donnerait du répit, celle qui permettrait de souffler un peu et de croire à nouveau à un endgame victorieux. Même si le plan d’ensemble de Marvel est flou, la série en elle-même est mouais, pas mal. Lorgnant un peu du côté d’Ally McBeal, SheHulk se concentre sur les déboires sentimentaux de son héroïne. Les dialogues ne sont pas aussi bon qu’une sitcom de bonne qualité, mais on sourit aux mimiques des avocats, aux situations. Les actrices, surtout, emportent et portent le show d’un bout à l’autre : Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga et Jameela Jamil. Tout est léger, rien ne prend la tête, c’est une balade sur un petit fleuve tranquille. Au final, She-Hulk est une fraise tagada. C’est bon mais avec des têtes brulées ce serait encore mieux. (En étant tout de même trèèèès bienveillant sur les effets spéciaux : She-Hulk se déplace comme un éléphant, toute en saccade et en décalage avec les décors…)
Pour qui chante Joyce Jonathan ? Pour des hommes, pour des femmes ? Pour des adolescentes, pour des plus-adolescentes depuis peu ? Longtemps, mon oreille distraite n’avait chopé que quelques mots, à peine une phrase, deci, de-là, quasiment toujours les mêmes. Des « and on and on and on » ad lib, ou des « na na na na na » entrainant. Voilà pour qui chantait Joyce Jonathan, me convainquais-je alors, elle ne chante pas pour moi, elle chante pour des femmes, elle chante pour des adolescentes, des petites bulles sentimentales, qui « pop » quand elles restent trop longtemps à l’air libre. La voilà sur mon étagère, finalement bien rangée, bien étiquetée, une sorte de Patrick Bruel au féminin. Seulement voilà. Un jour de covoiturage, j’ai écouté ce que chantait vraiment Joyce Jonathan. Je l’ai écouté, non pas comme on l’écoute quand elle passe à la radio, en faisant mille autres petites choses, non, je l’ai écouté comme si elle ne parlait qu’à moi. Et du coup, Bruel restera tout seul sur son étagère poussiéreuse. Parce que Joyce Jonathan chante peu de choses, mais elle le fait avec des mots justes, des mélodies parfaites. Elle écrit avant de chanter, ses mots résonnent, ses chansons renvoient à des pans de vie, des souvenirs oubliés qui ressurgissent, qui font mal ou rendent nostalgique. C’est une autrice, une écrivaine et comme Alain Souchon, elle croque son époque d’une formule assassine. « Pour vivre heureux, vivons clichés » (chanson sur les travers d’Instagram) « Tout le monde est plein d’espoir (Oh-oh, oh) / Tous, tous les mots sont dérisoires / On se regarde sans se voir / Et tout c’qu’on en retient, c’est bonjour, au revoir » Au final, Joyce Jonathan chante pour moi, de jolies petites choses
La leçon, c’est que tout le monde tombe aux champs d’honneur. De l’actrice au producteur, du figurant au preneur de son, tout le monde se prend des balles pour la passion du cinéma. Point final à la ligne. Dans un maëlstrom d’image, de couleurs, de sensation, le film nous le martèle : personne ne s’en sort vivant. Le cinéma consume. C’est une guerre incessante et infinie où les soldats perdus sont remplacés avant même leurs décès. Hollywood est un cloaque, glauque et lubrique. Tout le monde ment et tout le monde s’invente. Tout le monde se raconte des histoires pour rester debout et continuer à avancer plus ou moins droit. L’issue de la guerre ? Il n’y en a pas. Hier comme aujourd’hui, la guerre fait rage. Car c’est une guerre, à n’en pas douter. Ce n’est pas une succession de bataille, plus ou moins gagnées ou plus ou moins perdues, c’est une guerre avec son lot d’horreurs, de victimes et de profiteurs. C’est une guerre et c’est filmée comme une fête – éternelle elle aussi. On a envie d’en être, de connaître cette euphorie, de toucher du doigt l’éléphant de la gigantesque première scène. Et tant pis pour la note. Drogues, alcools, coups, blessures, trahisons, ce ne sont que les prix à payer, ils ne comptent pas. Demain, oui, demain, on veut bien s’occuper de l’addition. Qu’elle soit salée, quelle importance ? Tant que c’est gratuit et que l’argent coule à flots, on veut bien tituber jusqu’à la caisse. Le chemin qui y mène est constellée d’étoiles, de poudre et de joie. Sheers to the losers.